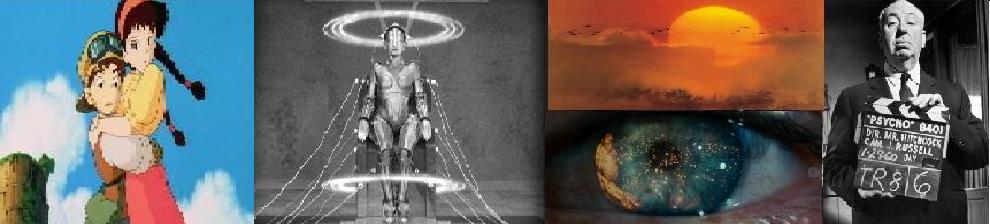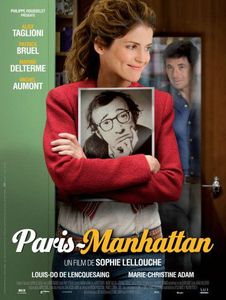Skyfall
Film américano-britannique de Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem
Sortie le 26 octobre 2012
Le genre : James Bond de crise
La note : 8
« Mon nom est Bond. James Bond ». 23 épisodes que l'icône de l'espionnage arpente la planète avec son Walther PPK, son martini et son smoking. Sous les traits de Daniel Craig, James Bond était devenu blond, les filles étaient moins maltraitées et les communistes se changèrent en terroristes. Avec cet nouvel opus, probablement le plus sombre de tous, les producteurs osent aller encore plus loin en s'interrogeant sur les fondamentaux même de la série. Magistral.
Skyfall pourrait se résumer par une terrifiante et inéluctable descente enfers du MI-6, les services secrets britanniques devenus légendaires grâce à la plume de Ian Fleming. Pour commencer, James Bond et une mystérieuse agente (dont je ne dis pas plus...) qui l'accompagne se démènent dans les rues d'Istanbul à la poursuite d'un type en possession d'une liste secrète de tous les agents déployés de la Couronne. On démarre donc avec de classiques scènes de courses-poursuites en moto, puis en train. Mais en vain : la liste a disparu et Bond est laissé pour mort. Pourtant, il reviendra en Angleterre prêter main forte au MI6 et à sa patronne, M, pour sauver les services des cyber-attaques et des attentats qu'il subit...
Gros boum en plein MI-6. Ambiance.
Il faut le dire, j'ai trouvé ce James Bond particulièrement réussi, pas tant sur le plan de l'action que sur la mise en scène de celle-ci, pas tant par une utilisation fidèle des éléments récurrents de la série que la réflexibilité que la franchise porte sur elle-même, pas tant par l'originalité de son scénario que par son vrai regard sur le monde. Et peu importe si on adhère ou pas – eh oui, je m'en expliquerai, j'ai trouvé cet épisode particulièrement engagé aussi. Bref, un film intelligent et une foison d'éléments intéressants à analyser, qu'il s'agisse des dialogues, des visuels, des actions. Je ne les relèverai pas tous, mais me cantonnerait à quelques éléments qui m'ont paru remarquables.
Première remarque, on a affaire à un James Bond dans un monde en mutation, à l'ère de la globalisation de l'économie, de la finance, de l'information. Cela fait déjà un moment que la franchise en fait le constat : déjà dans Goldeneye, le hacker Boris réalisait des cyberattaques pour le compte d'une organisation terroriste. Il est d'ailleurs possible de rapprocher le scénario de Skyfall de l'épisode de 1995 : le méchant Trevelyan y était aussi un traître à l'Angleterre et ex-agent du MI-6, animé d'un fort ressentiment contre M et Bond, à l'instar de Silva incarné par le très bon Javier Bardem. Skyfall ajoute à ce constat l'apparition d'un acteur nouveau, qui n'avait jamais eu son mot à dire auparavant : l'opinion publique. Il est demandé au MI-6 de faire la transparence sur ses activités. Les Indignés de 2011 sont-ils passés par là ? Image saisissante en tout cas que celle de M devant une commission parlementaire qui veut sa tête, donnant un véritable cours de géopolitique contemporaine sur fond de scènes d'action dans les rues de Londres venant appuyer ses propos sur les menaces non-étatiques, les réseaux et le « travail de l'ombre » entourant les services secrets.
"Je n'y crois pas, ce morveux va m'apprendre mon métier ?"
Deuxièmement, Skyfall tient compte d'une donnée lourde de ces dernières années : la crise économique et financière qui fait trembler le monde et particulièrement l'Europe. La Grande-Bretagne n'y échappe pas, l'austérité est non-dite mais plane comme une ombre au-dessus d'un gouvernement britannique forcé de faire des coupes partout dans les budgets. Le MI-6 devient alors une victime collatérale de la perte de souveraineté du pays face au pouvoir des marchés et des réseaux... mais aussi du rééquilibrage des relations internationales et de l'économie au profit de la Chine. En effet, après l'attentat au MI-6, il se trouve que Bond doit enquêter à Shanghaï. Loin d'être due au hasard, il s'agit de montrer que la destination est la véritable nouvelle capitale du monde, scintillante, imposante. Et menaçante. Cette menace n'est pas dénoncée explicitement (on est loin du racisme anti-jaune de L'homme au pistolet d'or...), on se contente de la montrer. Froidement, finement : le Chinois est un dragon dans le générique, qui draine des millions d'euros à Macao. L'espion anglais se bat en ombre chinoise et en silence dans un building sur fond d'une enseigne publicitaire aux belles et étranges volutes bleutées.
Par conséquent, il ne reste à Bond et ses amis du MI-6 qu'à se cramponner à la défense de la nation. Il opine sans brancher lorsque le méchant raille son « patriotisme » et lorsque le bureaucrate rival de M, Mallory (Ralph Fiennes) s'étonne qu'il cherche à reprendre du service après sa « mort » officielle en Turquie. Il me semble par ailleurs qu'il arrive que l'on regarde un James Bond sans voir un seul drapeau britannique à l'écran (à vérifier, je concède). Or, aurez-vous remarqué qu'il est présent partout ici, et même sur l'affiche du film ? Détail peut-être. Détail lourd de sens selon moi.
D'où ma troisième remarque : le retour aux sources. Et je trouve personnellement pas bête du tout que les réalisateurs posent la question franchement : qu'est-ce qu'est être un espion en 2012 ? En ce temps troublés, la figure de l'espion apparaît de plus en plus dépassée, vieillote, hors du coup. Cela n'a plus grand chose à voir avec l'époque de Sean Connery, bien plus simple, avec la Guerre Froide, le bon temps des colonies et l'insouciante brutalité envers les femmes...
Bon, juste histoire de se marrer un coup : http://www.youtube.com/watch?v=YJWfObq2cFk
Par ailleurs, 007 se plante lamentablement aux tests pour sa réintégration dans le service. La honte.
Au service secret de sa majesté, 007 est prêt à toutes les résurrections
Dans ces conditions, on revient aux fondamentaux. Q, un jeunot boutonneux et tête à claque, ne lui donne cette fois-ci que un Walther PPK et … une radio. « Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit Noël avant l'heure... » commente tristement Bond, après avoir été sérieusement mouché par le nouveau Q arrogant, croyant plus à l'efficacité de ses programmes informatiques qu'aux agents sur le terrain. « Il faut bien quelqu'un pour appuyer sur la gâchette » concède-t-il seulement. Voilà à quoi est réduit 007 désormais.
Mais pourtant, c'est en s'appuyant sur des éléments du passé que Bond trouvera les ressources pour réussir sa nouvelle mission. (Attention spoiler ici !) Il reprendra l'Aston Martin DB5 de Goldfinger pour éviter d'être tracé trop facilement par son ennemi et l'attirer dans un piège en Ecosse. Là, il y retrouvera la demeure de son enfance qui est évoquée par la première fois... La demeure elle-même qui sert d'ultime repli aux derniers du MI-6, pour un combat sombre, lugubre, inquiétant... bref une ambiance particulièrement réussie pour rapprocher M et Bond, jusqu'alors boss et employé depuis Goldeneye.
Et de tout cela, de son face à face final avec le méchant (qui n'est justement pas un face à face en fait), Bond n'en retirera pas grande gloire. Profitons pour saluer ce personnage de méchant machiavélique, déconcertant, cruel... et à des attitudes confinant à l'homosexualité. Eh oui, celle-ci est maintenant mise en scène dans James Bond, bien que cantonnée à des rôles de méchants. Bref, à l'issue du film, le prix à payer, y compris en amour-propre, est bien grand, les dégâts terribles, les pertes irréparables.
Il y a comme du malaise dans l'air.
Oh, et les girls dans tout cela ? On les aurait presque oubliés. Eh bien... insignifiantes. Bond sort bien un moment avec une française jouée par Bérénice Marlohe (par facilité?) qui n'est d'ailleurs pas la seule. Mais elle n'est pas essentielle. Moneypenny est aussi présente, qui pour la première fois est jouée par une métis. Le firt est présent, mais elle joue un rôle un peu surprenant, beaucoup plus dans le feu de l'action que son rôle de secrétaire laisse supposer d'habitude. Mais en fin de compte, seule une femme compte ici : M. M comme maman. Avec le garde-chasse du manoir des Bond à la fin du film, on retourne à une symbolique de la famille traditionnelle et ancestrale.

M n'est pas qu'une lettre
NB : Je n'ai pas habitude de commenter l'actualité cinématographique autrement que par les films que je visionne au cinéma. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de réagir à l'annonce de la vente de LucasFilm à Disney hier et à la production annoncée d'une nouvelle trilogie de StarWars à partir de 2015 !! En tant que fan, comme tant d'autres, qu'elle ne fut ma surprise hier soir, mêlé à la fois à de l'excitation... et de la crainte.
J'attends d'en savoir un peu plus avant de commenter plus avant ; nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque ressortira le prochain épisode en 3D, L'Attaque des Clones, courant 2013.